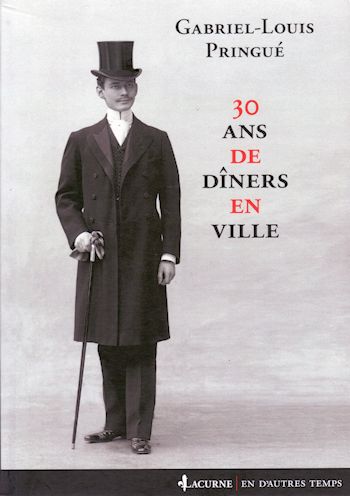Gabriel-Louis Pringué - 30 Ans de Dîners en Ville
Mrs. Corey Pages 314 à 317
Mrs. Corey était une cantatrice américaine qui avait créé aux États-Unis l'opérette La belle de New York, que j'avais vu jouer, dans ma jeunesse, à Londres. Mrs. Corey possédait, paraît-il une très belle voix de contralto. Elle charma un milliardaire américain, roi de je ne sais plus quoi, qui divorça et l'épousa. Elle ne chanta plus, vint habiter la France où son richissime mari lui fit don du beau domaine de Villegénis, près de Paris, et de son château, où le roi de Westphalie, Jérôme Bonaparte avait terminé sa remuante carrière.
On me racontait que Mrs. Corey faisant visiter la royale demeure à un érudit français lui dit : « Je vais vous montrer la chambre où Napoléon Bonaparte est mort. - Pardon, riposta l'érudit, c'est Jérôme Bonaparte » et Mrs. Corey de répliquer : « Oh ! c'est toujours un Bonaparte, c'est la même chose. » Elle avait une notion rudimentaire de l'histoire.
Le château était ravissant, nimbé de poésie romanesque, entouré de jardins très bien entretenus et d'un vaste parc boisé. Mr. Corey disparut de l'horizon. Les jardins ne furent plus entretenus. Le marquis de Castellane disait : « C'est une très belle culture d'orties. » Il restait cependant à l'état sauvage de massifs buissons de rhododendrons, une forêt de seringas, qui embaumaient au printemps et un vieux jardin romantique avec des arcades de roses où les fleurs non cultivées s'entêtaient à fleurir et à s'épanouir, superbes, en souvenir, probablement, du roi Jérôme.
L'endroit, néanmoins, était idyllique ; le désordre de la nature, qui permettait au caprice la liberté de sa fantaisie envahissante, dispensait un charme sentimental, évocateur du passé impérial et des parcs à l'anglaise. L' intérieur était peu meublé, les pièces énormes ; une petite salle à manger possédait de belles fresques peintes par Isabey représentant des paysages.
Mrs. Corey avait un physique particulier, deux yeux noirs énormes, beaux d'ailleurs, mais écarquillés, comme il arrive aux personnes à qui l'on pince subitement le derrière, et une bouche minuscule, verticale, au lieu d'être horizontale, car Mrs. Corey la fardait en hauteur. Certaines personnes mal intentionnées prétendaient que cette bouche était cousue sur les deux côtés, afin de paraître infinitésimale, et que l'on nourrissait Mrs. Corey grâce à des pailles et à des tubes dans lesquels on lançait de la viande hachée. Cela est faux, car j'ai pris beaucoup de repas avec elle, je me suis rendu compte qu'elle mangeait normalement. Il est vrai que sa bouche avait une forme si étrange, qu'un bedeau, dans une église, qu'elle visitait, lui fit la remarque : « Madame, on ne siffle pas dans les églises. »
Tout cela formait un ensemble drôle et amusant, car Mrs. Corey était bonne, gaie, enjouée, mais très snob et avait une prédilection pour la pompe des titres et des royautés, bien qu'elle n'ait eu aucune notion des généalogies ; aussi la duchesse de la Rochefoucauld déjeunant chez elle, et déclarant : « Mon beau-père, mort avant son père, est toujours demeuré duc de Liancourt », Mrs. Corey répliqua : « Ah ! le pauvre homme, quelle tristesse. »
Svelte et d'une taille ravissante, elle était hantée par la crainte d'engraisser, n'avalait que quelques feuilles de salades ou d'épinards, sa maigreur s'avérait squelettique. Très sportive, elle montait très bien à cheval parcourant sa propriété en tous sens en compagnie d'un vieux grand seigneur russe, ruiné avant le bolchevisme, peintre de talent, qui faisait d'elle des portraits dans ses exercices équestres.
Elle aimait beaucoup recevoir, se montrant très hospitalière donnait de grands déjeuners et dîners dont le menu était court. Elle avait inventé le plat unique bien avant que quiconque ait pu imaginer son existence. La boisson se trouvait aussi assez réduite. Pendant les courts séjours de son mari, le magnat d'Outre-Atlantique, qui était généreux, tout devenait subitement copieux, les alcools abondants. C'est à une de ces époques que la délicieuse lady Anglesey, qui habitait un moulin tout près et qui, octogénaire demeurait fascinante, m'amena déjeuner chez elle. Je me trouvais à un véritable festin de têtes couronnées. Il y avait le diadoque Constantin, plus tard roi de Grèce, le grand-duc Vladimir de Russie, le grand-duc de Leuchtenberg, des femmes élégantes jolies et au milieu de tout cet aréopage du gotha, un vieux monsieur chauve à lunettes d'or, qui ne connaissait personne, fumait cigare sur cigare, pendant le repas, lançant la bouffée de sa fumée au nez des altesses stupéfaites mais polies. C'était Mr. Corey. Il était le roi du dollar. Il valait bien les autres royautés. Il se considérait entre camarades. Je ne le revis d'ailleurs, que deux fois dans la suite. Il repartit pour l'Amérique pour toujours, divorça et s'y remaria. Les repas redevinrent brefs.
Naturellement, les histoires et les potins ont plu sur Mrs. Corey. Elle m'amusait beaucoup, car elle passait indifférente, affamée, pressée, courant de fêtes en fêtes, de dîners en dîners pour avaler quelques feuilles de salades entre deux ducs. On la rencontrait partout : à Paris, à Londres, à Rome, à Venise, sur la Côte d'Azur. En mars 1913 relevant d'une importante maladie, qui m'avait fait terriblement maigrir, je la rencontrais à Monte-Carlo. Elle s'écria en me considérant : « Vous êtes ravissant, on voit le jour à travers vous ». L'obésité lui faisait horreur et demeurait son cauchemar constant. Elle dansait sans arrêt, elle voyageait avec un gramophone dans son automobile, faisait arrêter la voiture en cours de route et sur un chemin de campagne, au son du gramophone valsait avec un de ses invités. Elle était reçue partout parce qu'elle était bonne fille. Tout le monde se précipitait à ses dîners de régime à l'hôtel Ritz où elle traitait les altesses et le "gratin" international. La capitale de son succès fut assurément Londres qui a un besoin essentiel de distractions et où lady Cunard et lady Colebrooke la protégeaient. Sa situation s'y montrait excellente.
En France et surtout dans ce plaisant Villegénis, elle était parvenue à recevoir de grandes personnalités : j'y ai déjeuné avec le ménage Philippe Berthelot, la baronne d'Erlanger, la princesse Rogatien de Faucigny-Lucinge, Réjane, le marquis d'Argenson, lady Duff Gordon, Sem qui la caricaturait sans arrêts dans ses albums et la marquise Casati, qui en plein hiver, vêtue de son pantalon de sultane en soie rose, de sa mante noire, demanda, pour goûter, des cerises ; on ne put lui en fournir qu'à l'eau-de-vie. Mabel Corey fut un moment très liée avec la richissime lady Michelham (la célèbre Berta) qui, lorsqu'elle venait déjeuner à Villegénis, lui dépêchait ses splendides valets de pied anglais dans leurs somptueuses livrées, son solennel maître d'hôtel, et une partie de sa vaisselle de vermeil. Les repas, dans la grande salle à manger décorée dans le style empire, devenaient alors magnifiques et servis dans le meilleur style. Il y avait chez Mrs. Corey un côté bohème divertissant. Sa tenue se prouvait toujours parfaite et, malgré l'absence totale de Mr. Corey, on ne lui connut aucune aventure.
Une fois, pendant un été, traversant la Touraine, elle s'invita, par télégramme, chez la princesse de Broglie à Chaumont-sur-Loire, pour vingt-quatre heures ; la princesse Amédée avait dîné souvent chez elle. Elle y arriva un matin de bonne heure dans une automobile grise, dont la forme avait précédé l'invention des tanks et qui faillit faire écrouler le pont-levis. La princesse étant encore couchée, ce fut le prince Amédée, digne et assez formaliste qui vint la recevoir. Il ne fut pas un peu surpris de voir sortir de la voiture, en plus de la femme de chambre indienne de Mrs. Corey, un chérubin rose et frais. Le prince demanda à Mrs. Corey le nom de ce jouvenceau. « Je ne le sais pas dit-elle, il est trop compliqué et comme il est Hollandais, je l'appelle Holland ». Le prince, assez refroidi par l'événement, remonta aussitôt chez sa femme pour lui en faire part. « Ne vous troublez pas, Amédée, lui répondit la princesse de sa voix nonchalante et qui avait beaucoup de philosophie, ils ne sont ici que pour vingt-quatre heures ; il faut leur donner deux chambres communicantes. » La communication ne servit pas, car comme je l'ai dit Mrs. Corey était chaste. Elle adorait les oiseaux.
Elle reçut la cour et la ville. Elle plaçait les gens n'importe comment devant un buffet quasi vide. Fut-elle une grande humoriste ? Mystère !
Gabriel-Louis Pringué
30 ans de dîners en ville
Lacurne - En d'autres temps
ISBN 978-2-35603-009-2
SOUVENIRS ET PORTRAITS de la haute société parisienne et cosmopolite de la Belle époque à la Seconde guerre mondiale.
Avec esprit et nostalgie, Pringué (1885-1965) décrit, en chroniqueur habile et passionné, ces salons où les femmes, dans des chatoiements de soie et de bijoux, s'entourent de souverains en exil, de princes et de ducs, d'aristocrates, de diplomates, de gens de lettres, d'élégants en habit... enfin, de ce qu'on appelle alors le "gratin". Des salons parisiens aux châteaux, des chasses à courre aux cercles les plus chics, l'auteur nous fait vivre dans l'intimité et l'exubérance publique des noms qui claquent encore dans l'imaginaire collectif: Youssoupoff, Boni de Castellane, la Païva, La Rochefoucauld, Rohan, Deux-Siciles, La Tour d'Auvergne, Broglie, Tour et Taxis, Wagram, Bibesco, Orléans-Bragance, Bourbon-Parme, les grands ducs russes, le sultan du Maroc, le maharadjah de Kapurthala et tant d'autres - dont on trouvera fort opportunément l'index en fin d'ouvrage - qui forment les personnages d'exception de cette pièce à huis clos. Un témoignage de « ce temps où, du moins pour quelques-uns, il était bien agréable de vivre ».
Première édition : Paris, Revue Adam, 1948
Préface de Jérôme et Jean Tharaud de l'Académie Française
Mon cher ami,
Vous AVOUERAI-JE que je n'aime pas beaucoup le titre que vous avez choisi. Votre livre est autre chose, et mieux, que des souvenirs de dîners. C'est le tableau d'une société parisienne et cosmopolite, que vous avez bien connue, et qu'on ne reverra plus.
Vous nous avez parlé très souvent de cette société singulière, quand vous nous faisiez le plaisir de venir nous voir dans notre maison des bords de la Rance, au pays de Dinan, où nous étions voisins. Notre maison bretonne n'avait rien, dans sa simplicité, des résidences somptueuses auxquelles vous étiez habitué. Elle n'a aujourd'hui de commun avec elles que d'être, elle aussi, du passé. Les Allemands, qui l'ont occupée pendant quatre ans, l'ont saccagée, brûlée à demi ; dans la prairie, sous les fenêtres de ce qui était notre cabinet de travail, ils ont construit un blockhaus indestructible ; plus loin, ils ont ouvert une carrière, d'où montait, tout le long du jour, le vacarme des pierres concassées, pour construire, dans le voisinage, à la place d'une forêt mystérieuse, un vaste aérodrome, qu'ils n'ont d'ailleurs jamais utilisé ; ils ont coupé arbres et haies, bouleversé tout le paysage, et l'ont rendu méconnaissable... Bref, nous avons mis la clef sous la porte, ou plutôt nous l'avons passée à d'autres, et quitté ce pays auquel nous étions si attachés par toutes les amitiés (dont la vôtre) que nous y avions formées, et où, pendant tant de mois d'été et d'automne, nous avons si agréablement travaillé.
Vous habitiez, vous habitez toujours, à deux pas de Dinan, votre propriété de famille, où poussaient de beaux arbres que les Allemands, n'ont pas épargnés davantage. J'entends, dans le bruit de la mer, la plainte de vos chênes et la plainte des nôtres, et celle de toutes nos forêts qui ont été meurtries, abattues, comme l'ont été tant de Français, avec une fureur imbécile.
Vous arriviez chez nous à bicyclette... un extraordinaire outil, qui était votre bicyclette de jeune homme, c'est-à-dire qu'elle devait avoir passé la quarantaine. Vous qui avez, poussée à un si haut point, la passion de l'élégance, des chevaux, des équipages, vous ne rougissiez pas d'enfourcher ce Pégase démodé et rouillé, car une bicyclette, à vos yeux, n'a jamais appartenu à l'univers des objets nobles, dignes qu'on y prête attention et qu'on témoigne à leur égard un soin méticuleux. Tel qu'il était, brinquebalant et horriblement lourd, votre vieux clou vous amenait avec bonne humeur aux Auffenais (c'était le nom de notre maison), vous et votre éternel oeillet à la boutonnière.
Vous avez fait, de notre demeure et de nous-mêmes, un tableau qui sublimise tellement la simple vérité qu'il me rend, je l'avoue, un peu sceptique sur la réalité des choses que vous racontez par ailleurs ! Vous avez, cher ami, l'imagination généreuse, l'émotion vive, l'épithète décorative (un peu trop à mon goût), un coeur frais comme votre oeillet, toujours prêt à la gentillesse et à magnifier ce qu'il reçoit... Mais là où vous vous ne vous trompiez pas, c'est sur la sincérité de notre accueil.
Vous nous faisiez alors le récit de vos souvenirs, qui nous divertissaient d'autant plus qu'ils peignaient des existences absolument étrangères à la nôtre, et dont nous n'avions à peu près aucune idée. Soit dit entre parenthèses, c'est une chose bizarre que nous ayons pu vivre dans le même temps, le même Paris, la même France, comme si nous appartenions à un temps, à un Paris, à une France, à une société qui n'avait rien à voir avec celle où vous avez vécu. Vous nous avez fait saisir combien, dans un monde comme le nôtre, il existe de compartiments qui n'ont vraiment aucune communication les uns avec les autres. Que savons-nous du monde des ouvriers ? Du monde des paysans ? Que savons-nous de ce monde du luxe et du plaisir que vous nous décrivez, et qui se subdivise lui-même en tant de catégories plus ou moins impénétrables. Chacun vit dans son coin, dans son plaisir, son esprit ou son travail, sans prendre garde qu'à côté de lui, les gens mènent une vie qui n'a presque rien à voir avec celle que l'on s'est faite à soi-même.
Vous, dès votre jeunesse, vous avez délibérément choisi de vivre à la conquête du plaisir, que vous ne sépariez pas du luxe et de l'élégance. Cela vous a fait traverser des milieux très divers et singuliers, à travers l'Europe entière, et voir de curieux personnages, dont il aurait été dommage, pour l'imagination, que le souvenir fût perdu. Je crois que vous avez prêté à ces hommes, et surtout à ces femmes, qui s'entouraient si volontiers d'altesses, de princes, de diplomates, de gens de lettres à la mode, de tout ce que vous appelez d'un mot affreux, mais qui avait cours en ce temps-là, "le gratin", je crois que vous leur avez prêté plus de consistance, d'autorité, d'intelligence et d'influence sur les événements qu'ils n'en avaient en réalité. Ce n'étaient pourtant pas des fantoches. Ces gens ont existé, qui étaient en jaquette dès le milieu du jour, et en habit tous les soirs ; ces femmes emplumées, empanachées, cuirassées de bijoux ; ces demeures extraordinaires, remplies de tableaux magnifiques et d'objets rares, et aussi d'une valetaille innombrable qui, de l'escalier aux salons, faisait figure sur les murailles et dont vous nous décrivez complaisamment les livrées ; ces boudoirs qui se voulaient mystérieux ; ces déjeuners à jour fixe, ces dîners, dont vous rapportez quelques menus extravagants ; ces conversations où l'on affichait, d'un air négligeant, ses relations mirifiques, et où chacun s'imaginait ingénument détenir le dernier secret de l'Europe et des chancelleries ; ces bals masqués où se dépensait autant d'esprit et d'invention que d'argent pour la gloire de Paris et son plus grand profit ; ces inoubliables chasses à courre, ces curées au clair de lune, et ces fastueuses réceptions dans la paix et la splendeur des campagnes.
Je n'attache pas à tout cela le prix que vous y attachez, et je crains que vous n'en ayez été un peu la dupe, comme vos hôtes eux-mêmes. Mais j'en reviens toujours là. Tout cela a existé, et rien que parce que cela a été, cela valait la peine d'être conservé par le souvenir écrit. Proust l'a fait à sa façon, qui était celle d'un romancier. Vous, plus modestement, vous l'avez fait en chroniqueur. Mais votre relation sera là pour attester la vérité de l'autre.
Cette société que vous avez fréquentée ressemble beaucoup, par certains côtés, à celle duXVIIIe siècle à la veille du cataclysme qui allait l'emporter. C'est une société d'oisifs, de riches et de privilégiés, renflouée, la plupart du temps, par l'argent américain. Elle ne manquait pas d'esprit, comme le prouvent tant d'anecdotes que vous avez recueillies. Et si parfois bien de ces mots sont assez déplaisants par leur défaut de clairvoyance et d'humanité, il en est beaucoup de ravissants, qu'il eût été bien regrettable de laisser tomber dans l'oubli.
Cette société ne manquait pas, non plus, ni d'une poésie, ni d'un romanesque que vous savez très bien voir et très habilement mettre en valeur; et ce que je préfère dans votre livre ce sont ces vies esquissées, entrevues par échappées, dont on ne sait ni le commencement ni la fin, ces récits qui excitent prodigieusement l'intérêt, et qui nous laissent, finalement, dans le mystère et la rêverie.
Ce monde, lui, s'est écroulé comme un château de cartes, comme à minuit, soudain, se sont volatilisés en fumée, les chevaux, le carrosse et les atours de Cendrillon - à moins, peut-être, qu'un monde tout pareil continue d'exister tout près de moi, sans que je m'en doute un seul instant... Ce qui est sûr, c'est que vous aussi, vous n'y participez plus, définitivement retiré que vous êtes dans votre ermitage dinannais. Avec tendresse et nostalgie, sans aucune amertume, vous avez remué vos cendres. À mesure que le temps passera et qu'on s'enfoncera davantage dans une existence de moins en moins colorée, et de plus en plus différente de celle que vous avez connue, vos souvenirs perdront cette frivolité, qui est leur charme d'aujourd'hui, pour prendre la consistance que prennent peu à peu les choses du passé quand elles sont vraies, bien observées, et dont on pense (dois-je dire avec regret ) « C'était tout de même là un temps où, du moins pour quelques-uns, il était bien agréable de vivre. » Jérôme et Jean Tharaud
de l'Académie française